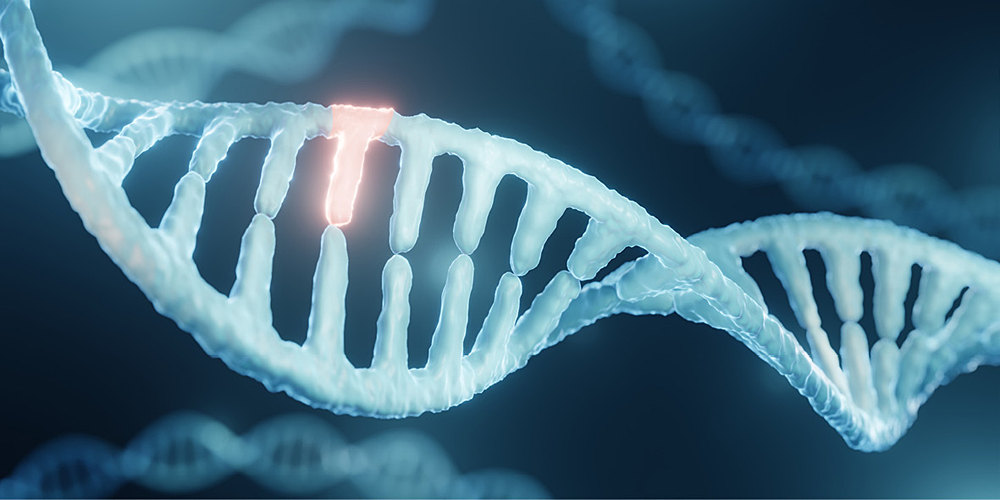Ce succès a été rendu possible grâce à des années de recherche, notamment grâce aux travaux d’Emmanuelle Charpentier et de Jennifer Daudna, co-lauréates du prix Nobel de chimie 2020 pour leur découverte de CRISPR-Cas9. Cette technologie permet de « couper » et de « coller » des sections d’ADN avec précision, à la manière d’un traitement de texte, ce qui en fait un outil puissant pour le génie génétique.
Publicité
CRISPR est déjà testé dans d’autres maladies, notamment la leucémie, la cécité héréditaire, la mucoviscidose et la maladie de Huntington. Ce succès dans la drépanocytose marque la première approbation d’une thérapie basée sur CRISPR par les organismes de réglementation, dont la FDA et l’EMA, ce qui signifie que la technologie passe du laboratoire à la clinique.
Cependant, des questions éthiques et techniques subsistent. Parmi celles-ci figurent le risque d’effets « hors cible » (modification des mauvaises sections d’ADN), le coût élevé de la thérapie (environ 2 millions de dollars par patient) et son accessibilité dans les pays pauvres où la maladie est la plus répandue.
Un débat est également en cours autour de l’édition germinale, c’est-à-dire des modifications transmises à la descendance. Bien que seules des cellules somatiques aient été modifiées dans ce cas, nombreux sont ceux qui craignent que cette technologie puisse servir à créer des « bébés sur mesure ». Une réglementation internationale stricte est donc nécessaire.
Cependant, le remède contre la drépanocytose est un symbole d’espoir. Il démontre que la thérapie génique peut faire plus que simplement soulager la souffrance, elle peut aussi éliminer la cause de la maladie. À l’avenir, CRISPR pourrait devenir un traitement standard pour des centaines de maladies héréditaires, transformant ainsi la médecine de réactive en médecine proactive.